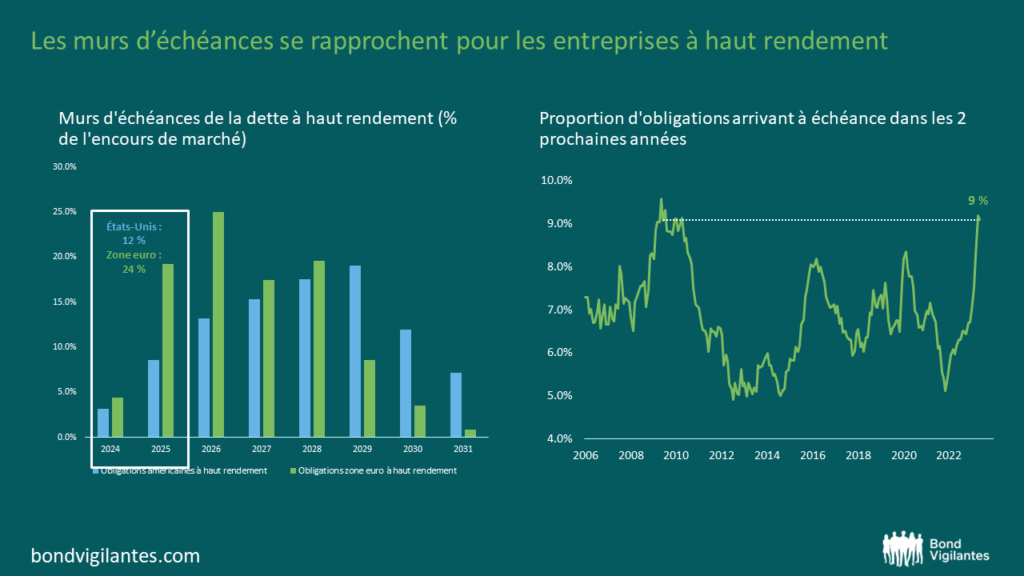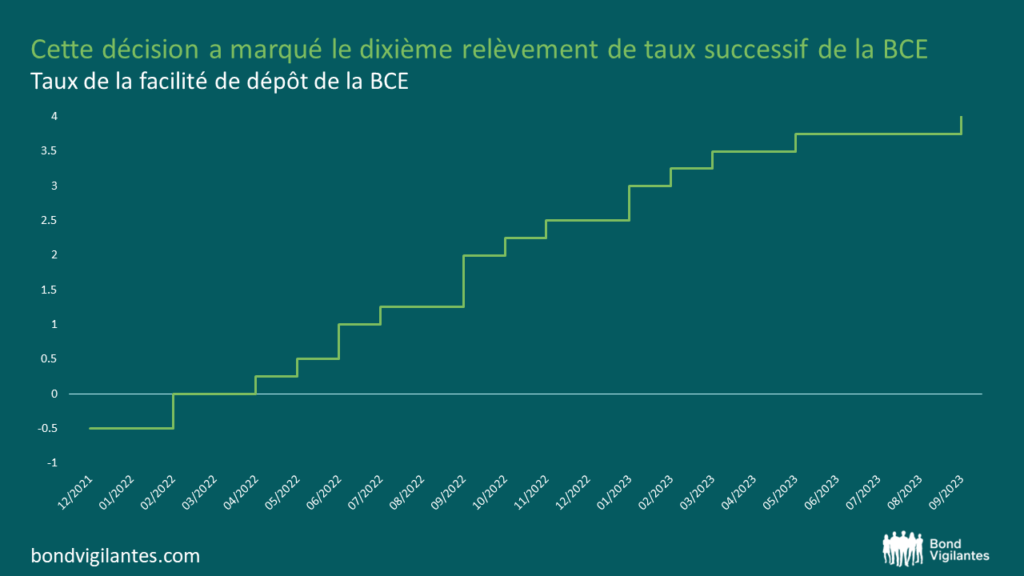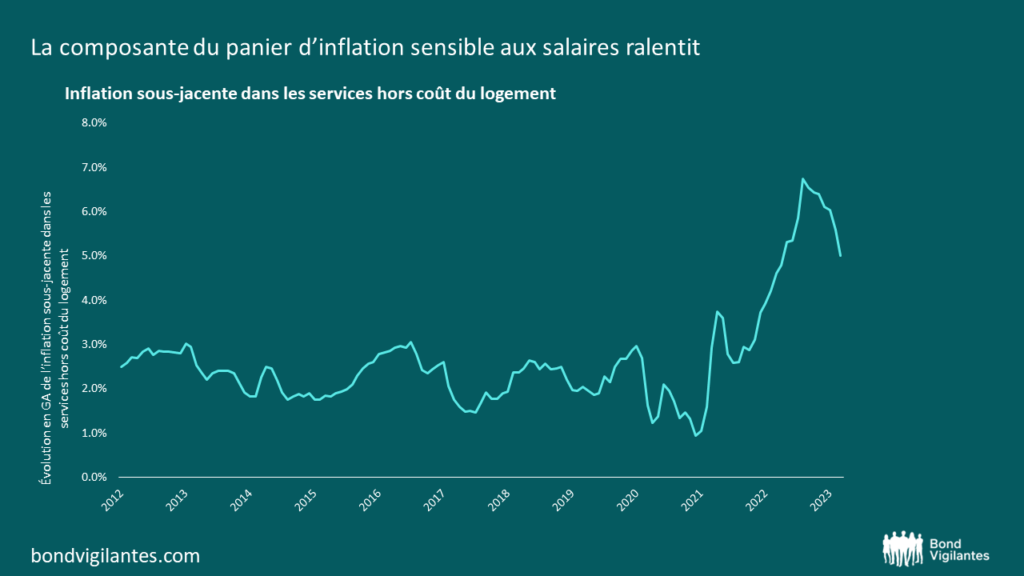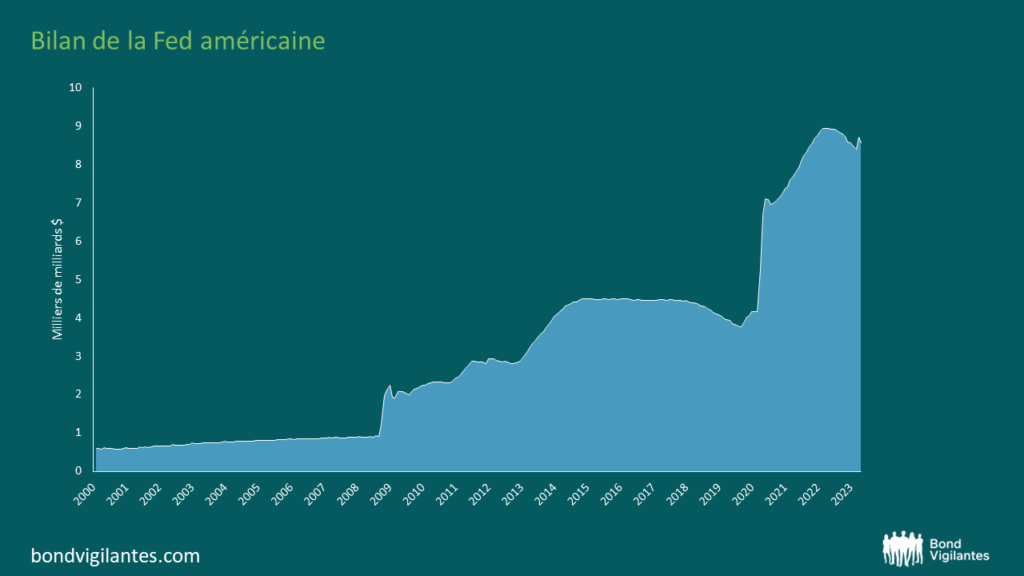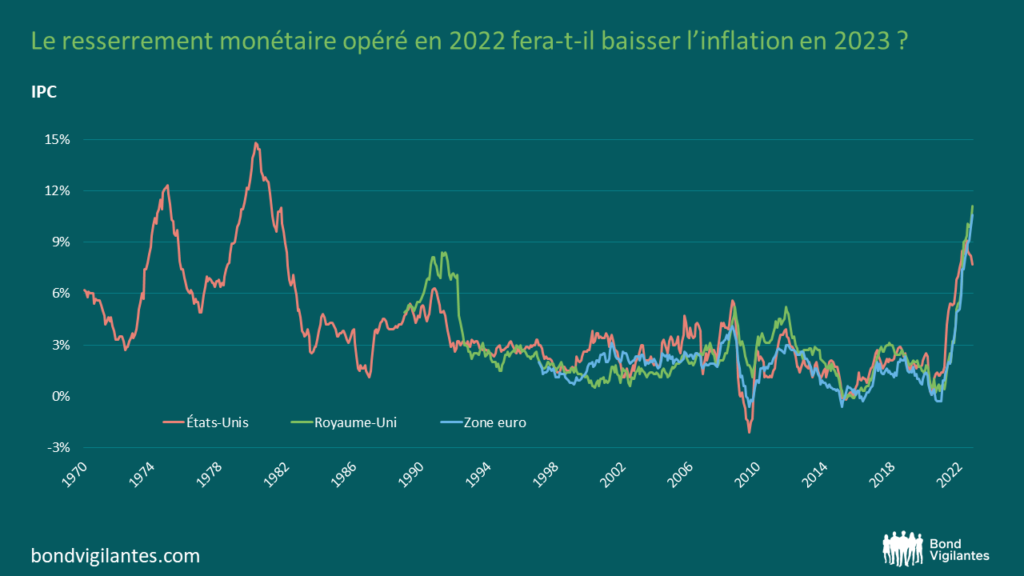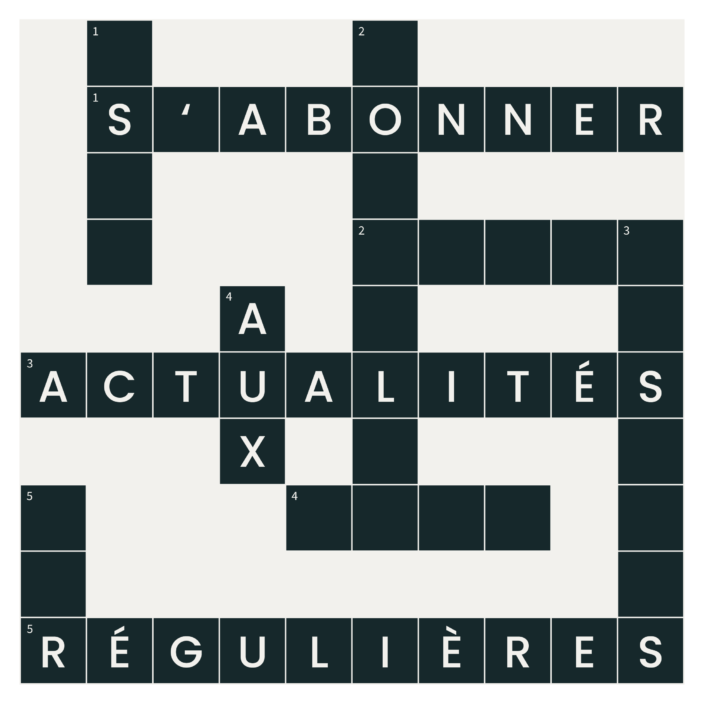Un thème récurrent dans les commentaires de marché ces derniers temps a été l’utilisation sans précédent du terme « sans précédent » ! L’achat d’obligations d’entreprises par les banques centrales, que l’on considérait autrefois comme sans précédent, est devenue monnaie courante. Maintenant qu’on le considère comme un outil monétaire conventionnel, il convient de se poser les questions « pourquoi ? » et « est-ce opportun ? ».
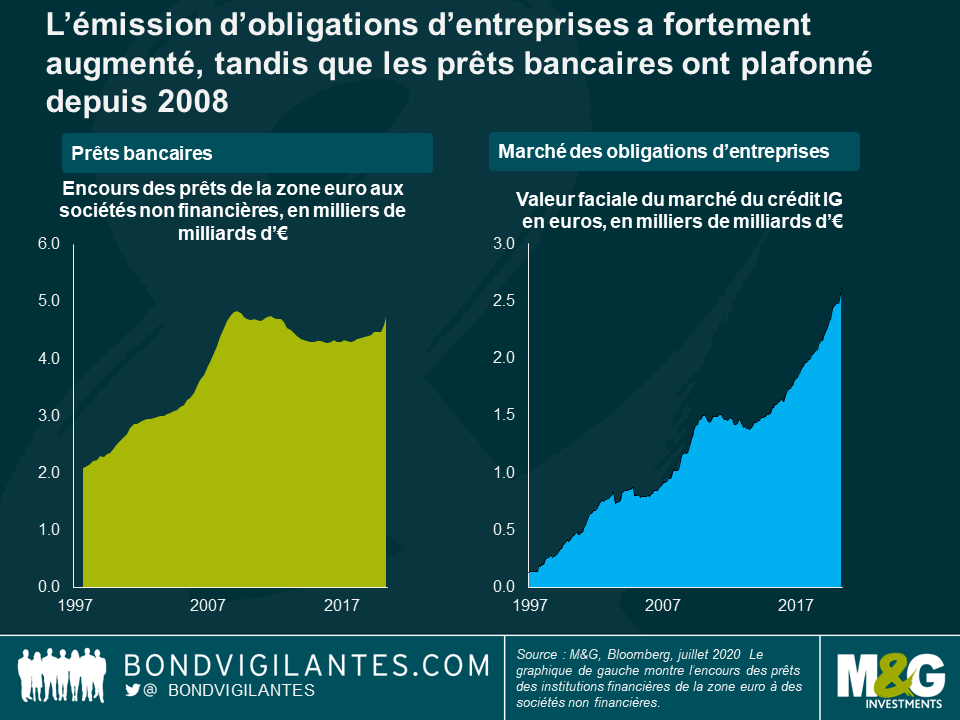
La première fois que nous avons mentionné par écrit l’achat d’obligations d’entreprises remonte à 2009. À l’époque, il s’agissait d’un outil monétaire inédit et sans précédent. Aujourd’hui, il fait partie de l’arsenal des banques centrales (voir le graphique ci-dessus), et même la Fed y a eu recours cette fois-ci. La grande crise financière mondiale a notamment eu pour conséquence un changement dans la manière de gérer le système financier par les autorités. À l’époque, c’est essentiellement le secteur bancaire qui était la principale source de la liquidité. Il empruntait à court terme et prêtait à long terme, en recyclant les capitaux ; c’est un mécanisme économique important et il était alimenté par la politique monétaire. Cette inadéquation du risque à terme a été atténuée par la réglementation sur les fonds propres, la surveillance financière et l’offre de garantie des banques centrales et des gouvernements, respectivement en tant que prêteurs et garants en dernier ressort.
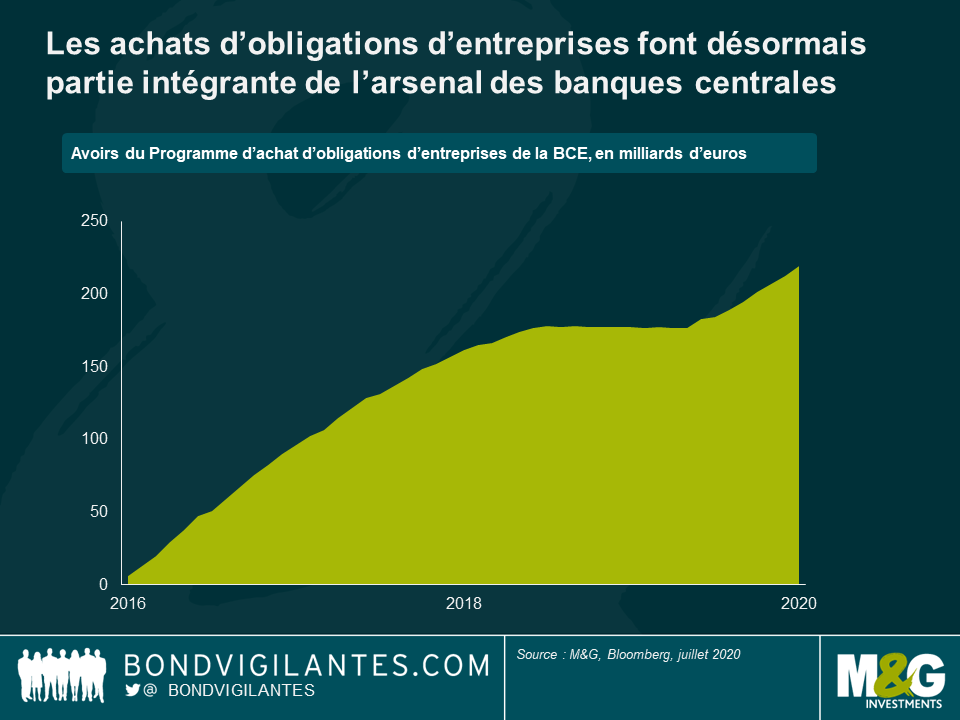
La crise financière a montré la vulnérabilité de ce système que nous, ainsi que d’autres, avons régulièrement évoqué. Un nouveau système était nécessaire. Les banques ont été dissuadées d’octroyer des prêts et se sont adaptées en conséquence : leur fonction vulnérable dans l’injection et le recyclage de capitaux a été complétée/remplacée en partie par le développement d’un modèle de financement à terme équivalent. Cela est clairement mis en évidence par l’explosion significative de l’encours des obligations d’entreprises, tandis que le crédit accordé aux entreprises et aux consommateurs a plafonné (voir le graphique ci-dessus). Les effets de cette transition, qui consiste à remplacer la dette bancaire à court terme par des capitaux à long terme, sont doubles :
- Les liquidités se font plus rares, car les émetteurs ont plus de mal à emprunter de l’argent. Le marché des obligations d’entreprises est une source de financement plus laborieuse et potentiellement plus coûteuse que le marché bancaire classique. La croissance est donc freinée car les marchés de capitaux sont moins dynamiques par nature. Un aspect négatif.
- Le cycle économique devient plus stable car il est plus difficile de créer les envolées et les effondrements qui accompagnent un marché bancaire en plein essor. Un aspect positif.
Ces deux effets ont été observés depuis la crise financière mondiale. La croissance a été lente et régulière, et non pas élevée et volatile.
Nous sommes maintenant confrontés à un ralentissement économique important en réponse aux besoins en matière de santé publique. Les gouvernements et les banques centrales du monde entier devaient réagir rapidement à cet événement historique. Dans toute crise, le rôle des banques centrales est d’être prêteur en dernier ressort. La structure plus stable des marchés financiers depuis la crise financière mondiale doit également s’inscrire dans le contexte traditionnel de la crise. Par conséquent, les programmes d’achats quantitatifs d’obligations d’entreprises visant à stabiliser les marchés en permettant à ce segment de fonctionner sont pertinents et constituent une mesure politique normale.
Le nouvel acheteur en vogue est la Fed. Par le passé, elle a été limitée dans son intervention sur les marchés financiers, mais elle est désormais à l’aise pour soutenir le financement équivalent que fournit le marché des obligations d’entreprises. Bien que ses achats d’obligations d’entreprises soient inédits, la Fed a l’habitude d’intervenir massivement sur les marchés du crédit privé puisqu’elle a déjà eu recours par le passé à d’importants programmes d’achat de MBS. Ses mesures récentes sont une extension de la nécessité de soutenir les marchés de financement à terme équivalent, comme elle l’a déjà fait sur le marché du logement américain.
Bien que le système post-crise financière ait évolué vers un système plus stable, il a encore besoin de soutien en temps de crise. L’achat d’obligations d’entreprises est une fonction naturelle des banques centrales pour soutenir le fonctionnement des marchés financiers en tant que recycleur efficace de capitaux.
Le premier semestre a été le témoin de l’une des corrections boursières les plus brèves et sévères de l’histoire sur fond de propagation du Covid-19 dans le monde entier. La rapidité et l’ampleur du rebond qui a suivi ont été tout aussi inédites, grâce avant tout aux gouvernements et aux banques centrales qui ont sorti l’artillerie lourde pour donner un coup de pouce à la liquidité et soutenir la confiance des ménages. En combinant la relance budgétaire et monétaire, la réponse politique mondiale est estimée à 14 000 milliards de dollars et ce n’est pas fini. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour les marchés internationaux au cours de la seconde moitié de 2020 et au-delà ?
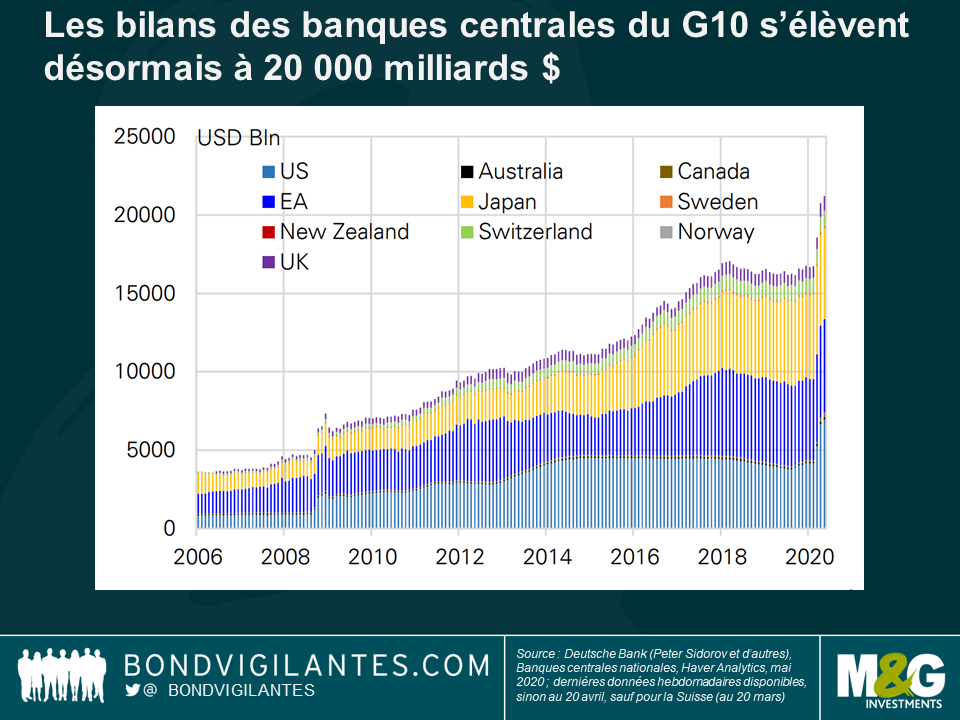
Le « taper tantrum » de 2020
Le second semestre sera placé sous le signe du nouveau « taper tantrum » ». Le premier avait trait à la diminution progressive de la taille du bilan de la Fed. Il s’était traduit par une hausse des rendements des emprunts d’État suite à l’annonce par la Banque centrale de la réduction graduelle de son programme d’assouplissement quantitatif (« QE ») en 2013. Celui-ci sera relatif à la fin des dispositifs de chômage technique dans les pays développés.
Les pays s’ouvrent à nouveau afin de limiter les dommages économiques, en particulier dans l’hémisphère nord où les gouvernements aspirent à soutenir la croissance au travers de la consommation estivale. Mais, compte tenu de l’absence de vaccin, une accélération des cas de Covid-19 est presque inévitable, même avec des mesures telles que des confinements locaux. Toutefois, les taux de mortalité seront inférieurs à ceux de la « première vague pour plusieurs raisons : nous disposons désormais de meilleurs traitements (par exemple, les stéroïdes réduisent les taux de mortalité dans les unités de soins intensifs), nous avons tiré des enseignements sur la protection des plus vulnérables et nombre des plus fragiles sont peut-être déjà décédés lors de la première vague. La plupart des économies développées devraient renouer avec une certaine forme de normalité.
Cependant, en dépit du récent rebond de l’emploi (voire les chiffres de l’emploi aux États-Unis la semaine dernière), le chômage demeure exceptionnellement élevé. Le nombre de chômeurs a augmenté de 12 millions par rapport à février aux États-Unis, tandis que plus de 9 millions de personnes sont sans emploi au Royaume-Uni, soit plus d’un quart des actifs britanniques. Jusqu’à présent, les dommages économiques causés aux particuliers ont été en grande partie atténués par des dispositifs de chômage partiel dans le cadre desquels le gouvernement paie un pourcentage important des salaires des employés qui auraient autrement été licenciés. En conséquence, avec peu d’argent à dépenser pendant le confinement, de nombreuses personnes ont ainsi pu économiser ou réduire leur endettement.
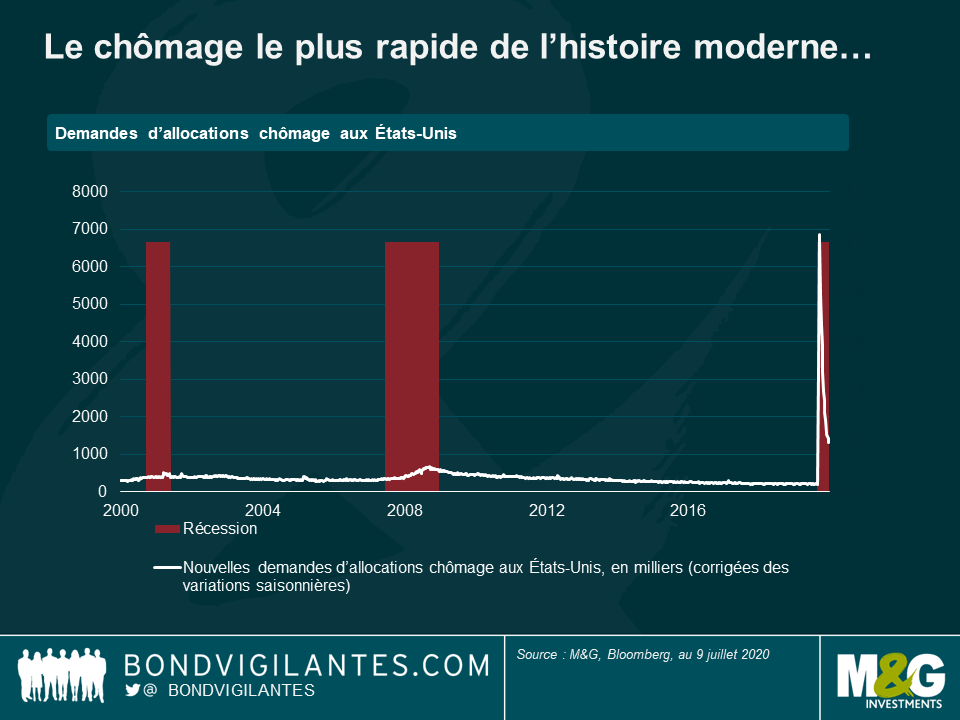
Outre-Atlantique, grâce à la loi CARES Act, le plus grand plan de relance économique de l’histoire des États-Unis, certains travailleurs se sont retrouvés dans une situation financière plus favorable sans emploi que lorsqu’ils en avaient un. Via des paiements directs aux Américains et des prêts aux entreprises, ce plan de 2 000 milliards de dollars représente 10 % du PIB américain et excède de loin la loi Recovery Act de 800 milliards de dollars de 2009. En additionnant la rémunération des employés et les allocations chômage du gouvernement, nous obtenons l’étrange situation dans laquelle des gens aux États-Unis perçoivent en moyenne plus de revenus maintenant qu’avant le Covid-19. Il s’agit d’une récession plutôt singulière : les récessions ne font normalement pas faire un bond aux revenus des ménages.
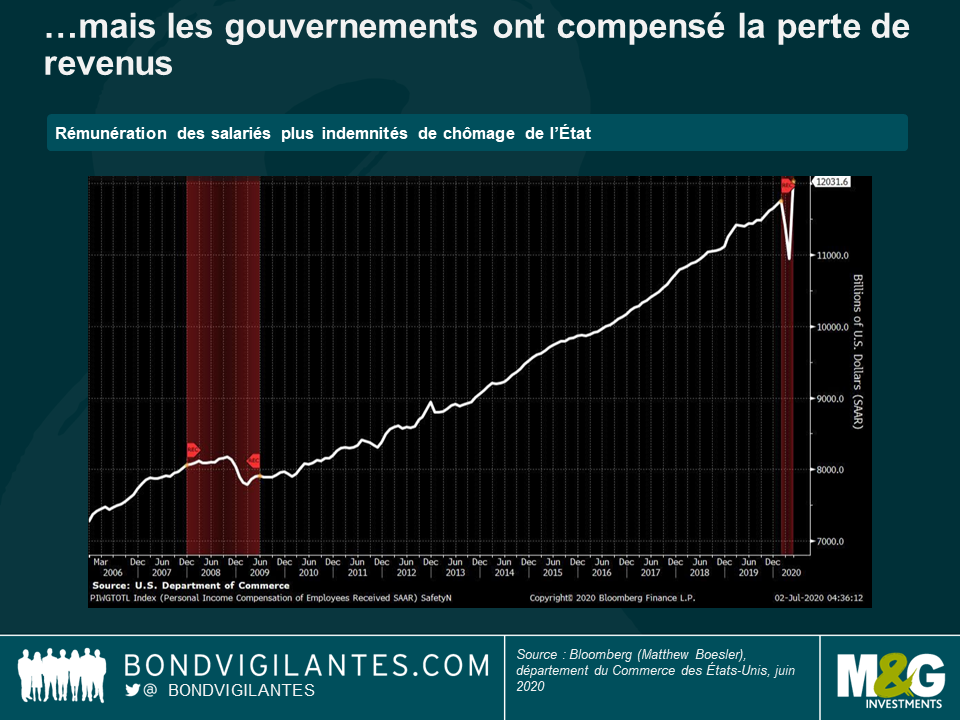
Le danger est dans la réduction progressive des aides d’État
Mais, que va-t-il se passer lorsque ces mesures de relance commenceront à être progressivement réduites ? Les niveaux d’endettement public ont explosé depuis mars sous l’effet de l’effondrement des recettes fiscales et de l’envolée des dépenses de chômage. Les déficits sont passés bien au-dessus de 10 % dans la plupart des économies développées, tandis que les ratios dette/PIB ont généralement atteint ou dépassé les 100 %. Si l’importance d’une telle situation est très controversée (se reporter au récent livre de Stephanie Kelton, The Deficit Myth, qui suggère que nous pouvons imprimer de l’argent pour sortir du problème ; ou au livre d’Eric Lonergan (de M&G) et Mark Blyth, Angrynomics, qui dit que le fait d’avoir des taux d’intérêt souverains négatifs rend le moment propice pour investir dans les infrastructures), la plupart des gouvernements veulent toutefois commencer à réduire graduellement les mesures d’aide à l’économie plus tard cette année. Au Royaume-Uni, cela signifie que les paiements de l’État au titre du chômage technique seront réduits en août et en octobre, faisant ainsi à nouveau peser une partie des coûts salariaux sur les employeurs.
Que va-t-il se passer alors ? En prévision de la fin du chômage partiel, des distributeurs britanniques, en particulier, ont déjà annoncé des licenciements massifs. Combien de salariés au chômage partiel dans le monde ne se rendent pas compte qu’ils sont en fait au chômage ? C’est pourquoi, en plus de l’impact continu du Covid-19 sur les voyages et le commerce au niveau mondial, ainsi que de la nervosité liée à la distanciation sociale (toutefois réduite par rapport à son pic), il semble difficile de concilier une reprise en « V » avec l’environnement actuel, en dépit de la faiblesse des taux d’intérêt et de la persistance de certaines mesures de relance budgétaire.
Les leçons de l’histoire
Il est probable que d’autres mesures de relance budgétaire vont être prises et que les niveaux d’endettement vont encore continuer d’augmenter. Comment allons-nous y faire face ? Les trois options habituelles sont : croissance, inflation ou défaut. La réponse est pour l’essentiel le même type de politiques qui ont permis au Royaume-Uni de réduire son endettement de 250 % du PIB après la Seconde Guerre mondiale. Cette politique comprend notamment des formes de pression financière comme le fait de forcer les banques à détenir une part importante d’emprunts d’État. Aux États-Unis, elle a consisté à artificiellement fixer les rendements obligataires au plus bas, à l’image du Japon depuis 2016 et de l’Australie en mars de cette année. Un tel contrôle de la courbe des taux fait déjà l’objet d’un vif débat au sein de la Fed (le contrôle de la courbe est différent du « QE » en ce sens qu’il vise un prix ou un rendement obligataire, plutôt que simplement l’achat d’un volume déterminé d’obligations). Pourrions-nous également voir des taux d’intérêt négatifs de la part de la BoE et de la Fed ? Cela est probable en cas de nouveau ralentissement.
Nous devons également songer à l’indépendance de la banque centrale. L’ancien vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Paul Tucker, a averti que, dans la mesure où la Banque achète désormais des gilts pour un montant quasiment identique à celui émis par le trésor de Sa Majesté (tout en offrant au gouvernement une facilité « Ways and Means » pour compenser la perte de recettes fiscales), elle risque d’être considérée comme le bras financier des autorités britanniques.
Le retour de l’inflation ?
Cette situation rend-t-elle l’inflation plus probable ? Cela reste encore à voir et dépendra en grande partie de celui qui remportera la bataille entre le travail et le capital dans le cadre de la reprise. Le travail a perdu depuis des décennies maintenant. Le Covid-19 va-t-il changer cela ? Jusqu’à présent, les données ne sont pas prometteuses : la dernière étude du groupe de réflexion américain Brooking Institute indiquent que ce sont les salariés du quintile inférieur qui ont connu les taux de chômage les plus élevés. Aussi, les espoirs de sortir de la crise en voulant récompenser les travailleurs clés mal payés (infirmières, livreurs, personnel des supermarchés) pourraient donc être déçus. Il existe toujours une possibilité d’inflation du côté de l’offre en raison de produits alimentaires non récoltés et des perturbations le long des chaînes logistiques. Le prix du panier a d’ailleurs bel et bien augmenté en mars, les magasins ayant mis fin à leurs promotions et limité leurs gammes de produits (et cette inflation a été infligée de manière disproportionnée aux ménages à faibles revenus en raison de la manière dont le confinement les a poussés à acheter davantage de nourriture tout en dépensant moins pour d’autres articles et activités moins inflationnistes). Mais, une inflation induite par la demande semble globalement très improbable.
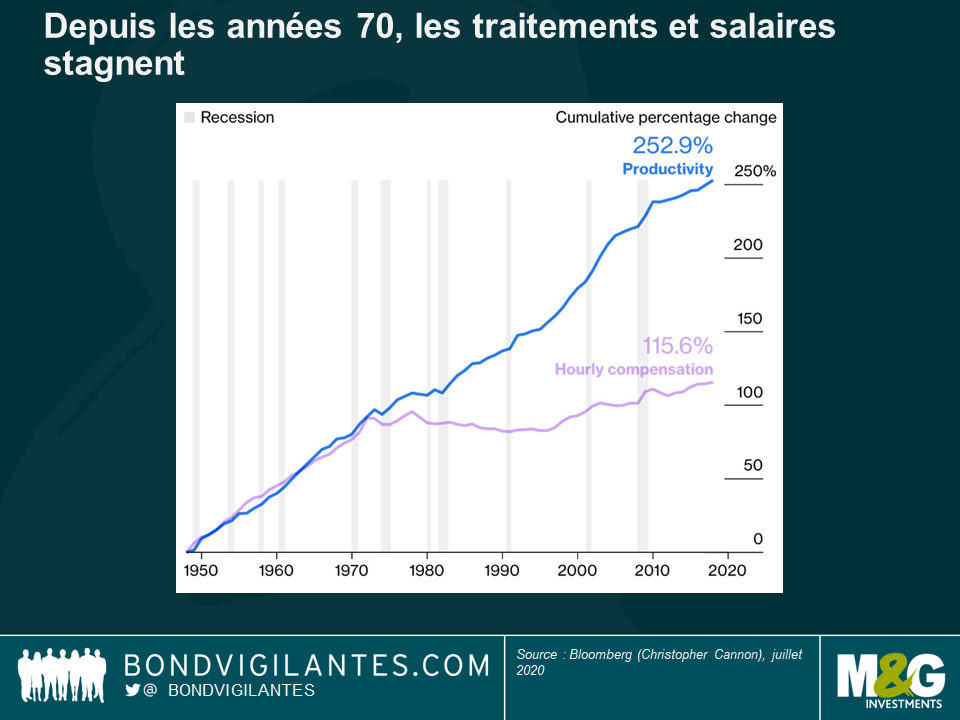
Selon l’opinion courante : « QE » = inflation. Est-ce vrai ? L’expansion de la masse monétaire est énorme – mais, l’effondrement de la vélocité de la monnaie (à savoir la vitesse à laquelle elle circule dans l’économie) l’est aussi. Certains affirment que l’effet le plus puissant du « QE » est celui sur une monnaie : sous l’effet de l’impression de monnaie, cette dernière se déprécie et l’inflation est générée par l’augmentation des prix des biens importés. Mais, qu’en est-il si tout le monde fait de l’assouplissement quantitatif ? Et si tout le monde essaie de déprécier sa devise ? Cela n’a du coup aucun impact. Le célèbre spécialiste des marchés baissiers Albert Edwards va plus loin en disant que le contrôle de la courbe des taux sera encore moins inflationniste dans la mesure où des pays comme le Japon ont pu maintenir des rendements à de bas niveaux sans même avoir à acheter beaucoup d’obligations – l’effet de signal est si puissant qu’il n’y a même pas d’expansion monétaire.
Se positionner en vue du nouveau « taper tantrum »
Obligations d’entreprises
Les valorisations des obligations d’entreprises ont fortement rebondi depuis les points bas de mars qui avaient offert d’excellentes occasions d’être surrémunéré pour le risque de défaut. Alors qu’à leurs plus bas niveaux, leurs cours intégraient des taux de défaut anticipés de 25 % dans la catégorie IG et de 54 % dans le haut rendement (au 23 mars 2020), les valorisations des obligations d’entreprises sont désormais plus proches de leur juste valeur (avec des taux de défaut anticipés de respectivement 12 % et 35 % au 7 juillet 2020). Il ne fait aucun doute que cette évolution a principalement été due aux achats des banques centrales, en particulier au sein du haut rendement où nous avons observé, et pouvons nous attendre à continuer d’observer, des défauts.
Malgré des volumes d’émission considérables, les spreads des obligations à haut rendement se sont sensiblement contractés. La raison principale n’est pas de nature fondamentale, mais plutôt les initiatives de la Fed qui a pour la première fois acheté des ETF à haut rendement et des obligations à haut rendement dégradées après le 22 mars. Il est difficile de s’enthousiasmer pour les valorisations du crédit à ces niveaux. La catégorie « investment grade » abrite toutefois encore des opportunités : il s’agit d’entreprises qui sont les grands employeurs, raison pour laquelle il est politiquement facile (et c’est sans doute un outil monétaire convenable) de les aider.
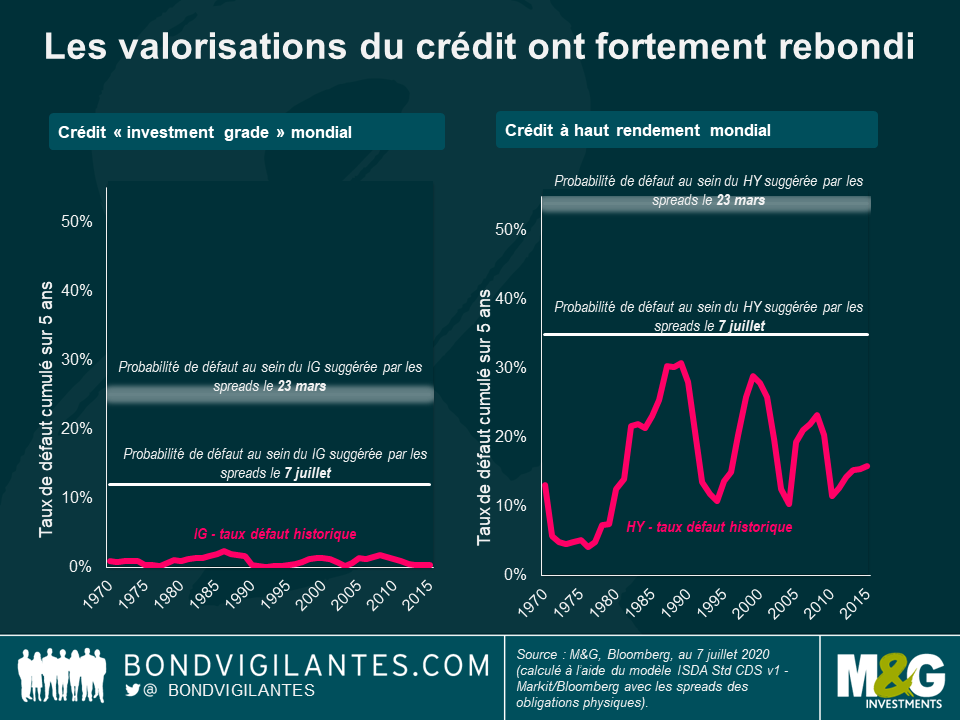
Le soutien de la Fed soulève également la question suivante : est-il juste que ces entreprises survivent ? Nous avons perdu le pouvoir créatif de la destruction, où l’ancien fait place au nouveau. Le capital est-il vraiment affecté correctement et efficacement ? Nous avons vu comment la croissance et la productivité stagnent dans ces conditions en Asie à la fin du siècle dernier.
Marchés développés
En dépit des vastes mesures de relance budgétaire mises en place, il est désormais difficile d’être trop pessimiste à l’égard des emprunts d’État au regard du monde caractérisé par un contrôle des rendements dans lequel nous vivons. Et les obligations aiment les mauvaises nouvelles : elles sont certes clairement très chères, mais elles offrent néanmoins un potentiel haussier en cas de retour d’un sentiment négatif sur les marchés au cours du second semestre. Dans la mesure où il est peu probable que l’inflation accélère de manière significative à court terme, je n’ai rien contre le fait de détenir de la duration.
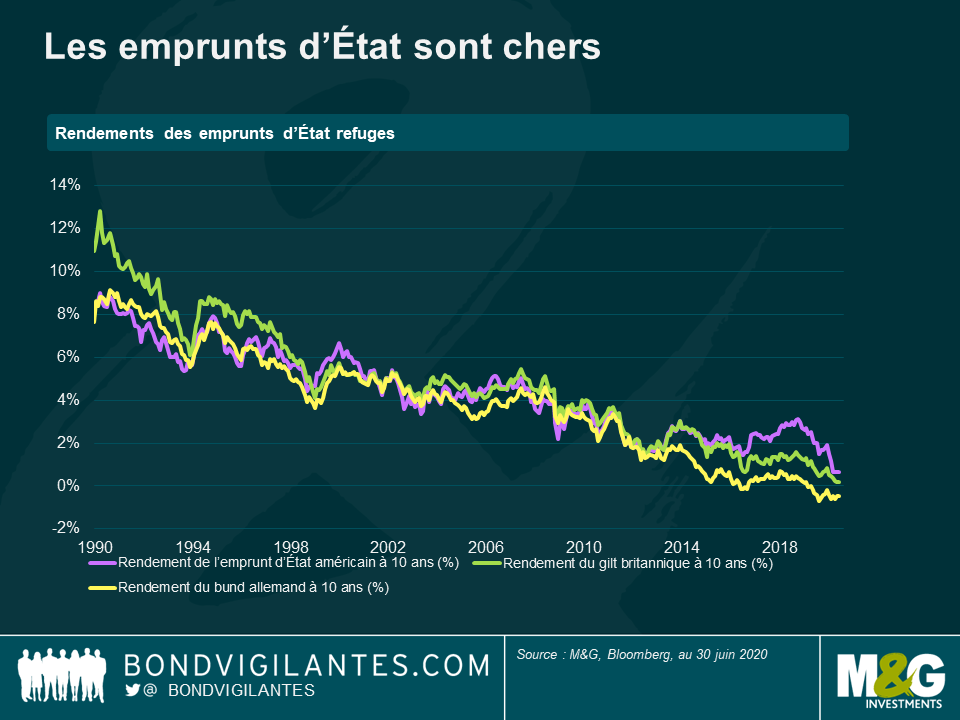
En Europe, le fonds de relance prévu et la poursuite du programme d’achat d’urgence en cas de pandémie ont été d’un grand soutien. Tout aussi important que les dépenses prévues elles-mêmes est le sentiment du partage de la charge, lorsqu’il s’agit de contribuer à contenir le risque de désintégration de l’UE. Malgré une certaine résistance aux plans de relance de la part des pays de la zone euro plus économes, les BTP italiens et d’autres obligations périphériques ont fortement surperformé les emprunts d’État des pays centraux depuis l’annonce. Je ne suis pas convaincu que les BTP vont continuer de surperformer depuis leur solide hausse. Les flux de capitaux marquent le pas dans la mesure où les spreads se resserrent, si bien que la demande devrait se déplacer vers d’autres États à haut rendement de la région qui ont été achetés de manière moins intensive jusqu’à présent par la BCE et les investisseurs. C’est pourquoi j’aime les obligations comme celles des Pays-Bas à 10 ans.
Marchés émergents
Une classe d’actifs dans laquelle j’identifie des opportunités est la dette des marchés émergents. Premièrement, elle offre des rendements réels plus élevés que les obligations des marchés développés. En outre, les devises émergentes ont été à la traine dans le rebond ; certaines obligations en devise locale offrent ainsi des valorisations attractives (vous pouvez en acheter plus pour 1 dollar). Les marchés émergents sont clairement confrontés à des difficultés liées au Covid-19, en particulier en raison des conséquences négatives sur le commerce mondial, mais une plus grande intervention des banques centrales des pays émergents que dans le passé est un facteur positif et il existe des poches régionales de valeur relative. Par exemple, je m’attends à ce que l’Asie surperforme les autres régions émergentes dans la mesure où les taux réels élevés rendent les devises asiatiques globalement attractives pour les investisseurs. En outre, nombre de ces économies étant des pays exportateurs nets, cela devrait également contribuer à améliorer les soldes des balances courantes.
Devises
Nous devrions observer un retour à la moyenne des valorisations qui ont évolué de manière agressive au cours du 1er semestre. Si les devises émergentes apparaissaient fondamentalement bon marché au 1er semestre, je m’attends à assister à de nouvelles fluctuations basées sur les fondamentaux. Ainsi, je prévois donc d’arbitrer certaines des devises qui se sont fortement appréciées (par exemple, la roupie indonésienne) au profit de celles de pays dont la situation budgétaire et la position de la banque centrale sont solides, mais dont les valorisations apparaissent encore attractives (par exemple, le rouble russe). J’aurais également tendance à favoriser les devises à bêta plus élevé (par exemple, celles de pays qui sont fortement axés sur les matières premières ou qui dépendent de la demande extérieure plutôt que de la demande intérieure) afin d’exploiter tout retour à la moyenne au cours du 2ème semestre. De même, je suis de près les initiatives des banques centrales : les devises des pays où les banques centrales ont été relativement prudentes dans l’expansion de leurs bilans (par exemple, le dollar néo-zélandais par rapport au dollar australien) sont là où je souhaite qu’elles soient (bien qu’en matière de taux, je privilégierais les émetteurs dont les banques centrales confèrent un solide soutien).
Contrairement à de nombreuses devises émergentes, le dollar apparaît fondamentalement assez cher. Pour autant, je possède bel et bien une certaine exposition au dollar dans la mesure où il joue son rôle dans un environnement d’aversion au risque. Dans l’ensemble, je préfère cependant le yen japonais pour la plus grande diversification et la meilleure protection contre l’aversion au risque qu’il offre. La BCE ayant éliminé une grande partie du risque baissier dans la région grâce à son ambitieux programme d’achat, j’apprécie aussi de détenir de l’euro. Il s’est transformé en actif très cyclique (il s’apprécie quand le sentiment s’améliore, à l’inverse du comportement du dollar), raison pour laquelle je le détiens contre la devise refuge de la région, le franc suisse.
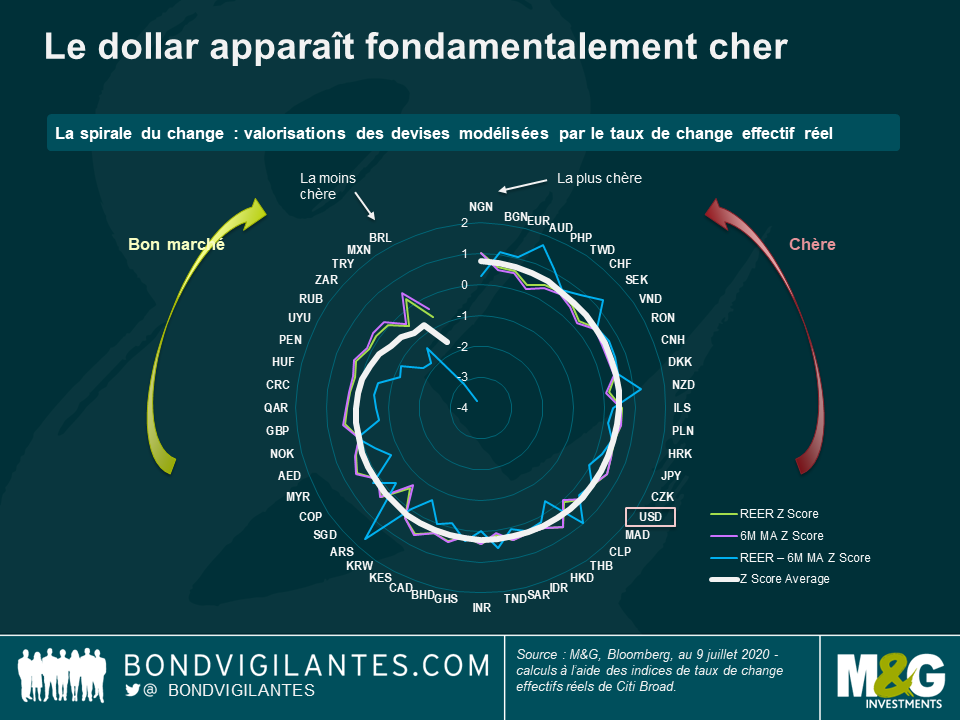
Fluctuations à court terme, impact à long terme
Le centre de l’attention des marchés financiers évolue rapidement et nous avons pu voir à quelle rapidité au cours du 1er semestre 2020. Après la brève et sévère correction provoquée par le mouvement de panique lié à la propagation du Covid-19 dans le monde entier, l’ampleur du rebond des prix des actifs révèle la nouvelle préoccupation principale des marchés : l’ampleur sans précédent des mesures de relance budgétaire et monétaire. Avec des millions d’emplois perdus en quelques mois, il ne fait aucun doute à mes yeux que ce sont ces mesures de relance qui pilotent désormais les marchés : ils sont influencés par des facteurs techniques, non par les fondamentaux. Je pense que le centre de l’attention pourrait changer tout aussi rapidement au cours du 2ème semestre et ce sera le revers de la médaille : que feront les marchés lors de la fin inévitable du relais monétaire et fiscal ?
Les gouvernements et les banques centrales ont, en apparence, réussi à contenir une grande partie des répercussions financières de la baisse de la demande due aux mesures de confinement. Le danger est désormais dans la réduction progressive des aides d’État. Ce faisant, il semble difficile d’étayer l’idée d’une reprise en « V ». Et la réponse à court terme des gouvernements et des banques centrales soulève des questions à plus long terme. Comment allons-nous nous sortir de tout cet endettement ? La croissance ? Il semble peu vraisemblable que la croissance tendancielle soit plus élevée après cette crise qu’avant. L’inflation ? Les banques centrales n’ont pas été capables d’atteindre leurs objectifs en matière d’inflation, même en période favorable, alors quelles sont leurs chances de réduire la dette publique en accélérant l’inflation maintenant ? Le défaut ? Il n’est pas nécessaire de faire défaut si vous pouvez imprimer votre propre monnaie – mais nous pourrions voir quelques jubilés des dettes (annulation de prêts étudiants par exemple), des impôts sur la fortune, des saisies et même l’annulation d’emprunts d’État détenus par les banques centrales dans le cadre du « QE ». Et que se passera-t-il si le marché cesse de croire que les banques centrales sont indépendantes ? Cela pourrait-il enfin être le catalyseur propice à un retour des anticipations inflationnistes dans les pays développés et, après des décennies de défaite, le travail va-t-il cette fois-ci l’emporter sur le pouvoir du capital ? Les mesures prises en l’espace de quelques mois soulèvent ces questions et bien d’autres encore. Nous pourrions devoir attendre des années avant d’en connaître les réponses.
Sommaire: L’UE s’est donnée pour mission de faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050. L’événement est plutôt passé inaperçu parmi les nombreux titres liés au Covid-19, mais le Parlement européen a approuvé 18 juin, et l’a traduit en dispositions législatives, le système de classification écologique unifié de l’UE qui est également connu sous le nom de taxonomie européenne des activités durables. L’un des piliers de la nouvelle réglementation consiste à déterminer si une activité économique peut être considérée comme un investissement vert ou non, ce qui permet de fournir un seuil précis à l’industrie de la gestion d’actifs pour les transactions relatives aux financements verts. Si les critères de sélection pour certains segments du marché sont encore en cours de définition par le groupe de travail technique , il est toutefois clair que les critères d’éligibilité fixés sont stricts. C’est sans aucun doute la bonne chose à faire si nous voulons atteindre l’objectif ambitieux de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels.
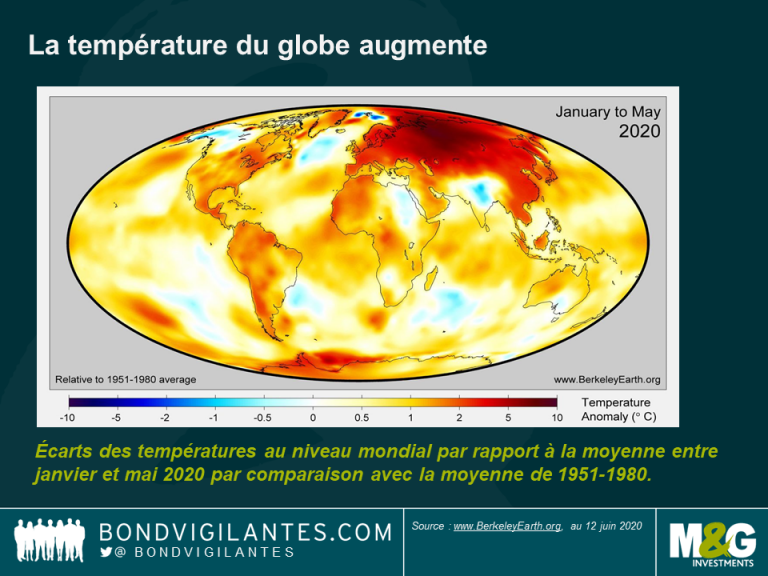
La demande mondiale d’énergie est appelée à continuer de croître au cours des 30 prochaines années, sous l’effet de l’augmentation de la population et de l’expansion économique. Et si les solutions renouvelables continuent de voir leur part de marché gagner du terrain, les combustibles fossiles devraient néanmoins encore représenter au moins 50 % du mix énergétique mondial en 2050 même dans le scénario le plus optimiste, selon la recherche de Barclays. Il en résulte que pour parvenir à un monde bas carbone, les entreprises existantes, en particulier les secteurs industriels, doivent décarboner et atténuer le risque climatique.
Toutefois, l’obstacle à l’émission d’obligations vertes par les entreprises à forte intensité carbone demeure élevé. En effet, ces émetteurs craignent d’arriver sur le marché avec une obligation verte et d’être critiqués pour cela. Il n’est ainsi pas surprenant que les groupes pétroliers et gaziers ne pèsent que 0,47 % dans l’indice BofA Merrill Lynch Green Bond, alors que leur poids dans l’indice BofA Merrill Lynch Global Corporate est de plus de 8 %. Malgré cela, je dirais que les entreprises opérant dans des secteurs industriels jouent un rôle important dans la transition énergétique dont nous avons besoin. Nombre d’entre elles sont des acteurs importants déjà dotés de larges structures capitalistiques et de départements de Recherche & Développement importants afin d’accélérer le changement indispensable. Le mois dernier, Total a acquis une participation de 51 % dans Seagreen 1, un projet de parc éolien offshore en mer du Nord estimé à 3 milliards de livres sterling. Peu d’acteurs ont la puissance de feu financière et la capacité d’assumer le risque de construction pour un projet aussi important.
Mais, qu’en est-il des activités qui ne peuvent être classées comme écologiques, mais qui jouent pourtant un rôle important dans la réduction de l’empreinte de gaz à effet de serre d’une entreprise ? Comment l’industrie de la gestion d’actifs peut-elle encourager un tel comportement pour les entreprises dont le cœur de métier n’est pas (encore) compatible avec un financement vert ?
Une solution possible pour permettre aux industries à forte intensité carbone de recevoir des fonds de la part des investisseurs responsables est l’émission d’obligations de transition énergétique. Il s’agit d’obligations émises dans le but de permettre d’évoluer vers un modèle économique plus écologique. Jusqu’à présent, cette idée n’en est qu’à ses débuts avec seulement une demi-douzaine d’obligations de ce type lancées. Le mois dernier, la société italienne de transport de gaz Snam a lancé sa première obligation de transition officielle via une opération de 500 millions d’euros. Le produit sera utilisé pour financer des projets éligibles liés à la transition énergétique, tels que définis par le Cadre d’obligations transitoires de la société. Par exemple, ce produit peut être lié à des projets d’énergie renouvelable en préparant des conduites de gaz pour hydrogène ou à des programmes d’efficacité énergétique en installant des chauffages dotés de technologies plus efficaces pour réduire les émissions de méthane. Cette nouvelle émission a été bien accueillie par les investisseurs obligataires et a été trois fois sursouscrite.
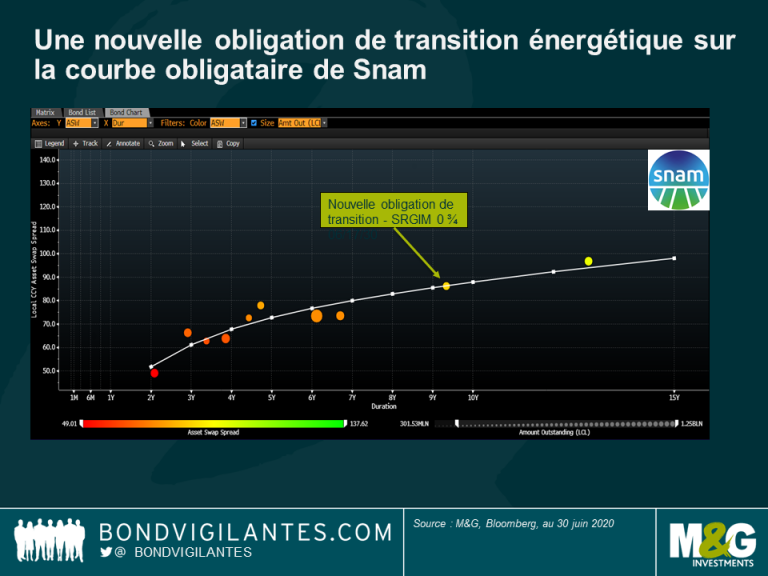
Pour autant, les premiers jours du marché des obligations de transition avaient suscité un peu de scepticisme de la part des investisseurs obligataires. En 2019, un producteur de viande bovine a émis une obligation de transition dans le but d’utiliser ces fonds pour acheter du bétail à des fournisseurs qui avaient accepté de ne pas détruire davantage de forêt tropicale. Nombreux ont été ceux estimant que l’entreprise n’aurait tout simplement pas dû acheter du bétail provenant de zones déboisées.
Cela souligne l’importance de l’existence de garde-fous et la nécessité de normes d’obligations de transition à l’échelle de l’industrie de la gestion d’actifs. Les acteurs du marché ont besoin d’un cadre de référence qui définisse les critères d’éligibilité pour l’utilisation du produit de l’émission de ces obligations de transition, notamment au regard des améliorations énergétiques minimales qui doivent être réalisées, de la manière dont elles sont mesurées et communiquées, et de la mesure dans laquelle une telle transaction doit être liée à la stratégie de transition plus globale de l’émetteur. C’est la seule façon de gagner la confiance des investisseurs et de permettre aux obligations de transition de devenir un marché plus accepté et plus profond. La taxonomie de l’UE va fournir des indications précieuses qui permettront de déterminer si l’utilisation prévue des fonds par une entreprise est suffisamment bonne pour pouvoir prétendre au statut d’obligation de transition. Si elles sont bien conçues, les obligations de transition peuvent offrir une importante classe d’actifs supplémentaire aux émetteurs, parallèlement aux obligations vertes, et ainsi contribuer à prévenir « l’écoblanchiment » sur le marché des obligations vertes.
Si le cadre de référence adéquat est mis en place, les obligations de transition énergétique pourraient constituer la prochaine évolution des investissements en faveur d’une économie bas carbone, combler un écart important et aider à mobiliser davantage d’actifs pour lutter contre le changement climatique. Les émetteurs pourraient ainsi obtenir un meilleur accès à une base d’investisseurs responsables de plus en plus importante, tandis que les investisseurs obligataires verraient l’éventail de leurs opportunités considérablement s’accroître, d’où au final un impact plus important en matière d’atténuation du risque climatique. Une situation dans laquelle tout le monde est gagnant : les investisseurs obligataires, les émetteurs et la planète.
L’UE s’est donnée pour mission de faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050. L’événement est plutôt passé inaperçu parmi les nombreux titres liés au Covid-19, mais le Parlement européen a approuvé 18 juin, et l’a traduit en dispositions législatives, le système de classification écologique unifié de l’UE qui est également connu sous le nom de taxonomie européenne des activités durables. L’un des piliers de la nouvelle réglementation consiste à déterminer si une activité économique peut être considérée comme un investissement vert ou non, ce qui permet de fournir un seuil précis à l’industrie de la gestion d’actifs pour les transactions relatives aux financements verts. Si les critères de sélection pour certains segments du marché sont encore en cours de définition par le groupe de travail technique , il est toutefois clair que les critères d’éligibilité fixés sont stricts. C’est sans aucun doute la bonne chose à faire si nous voulons atteindre l’objectif ambitieux de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels.
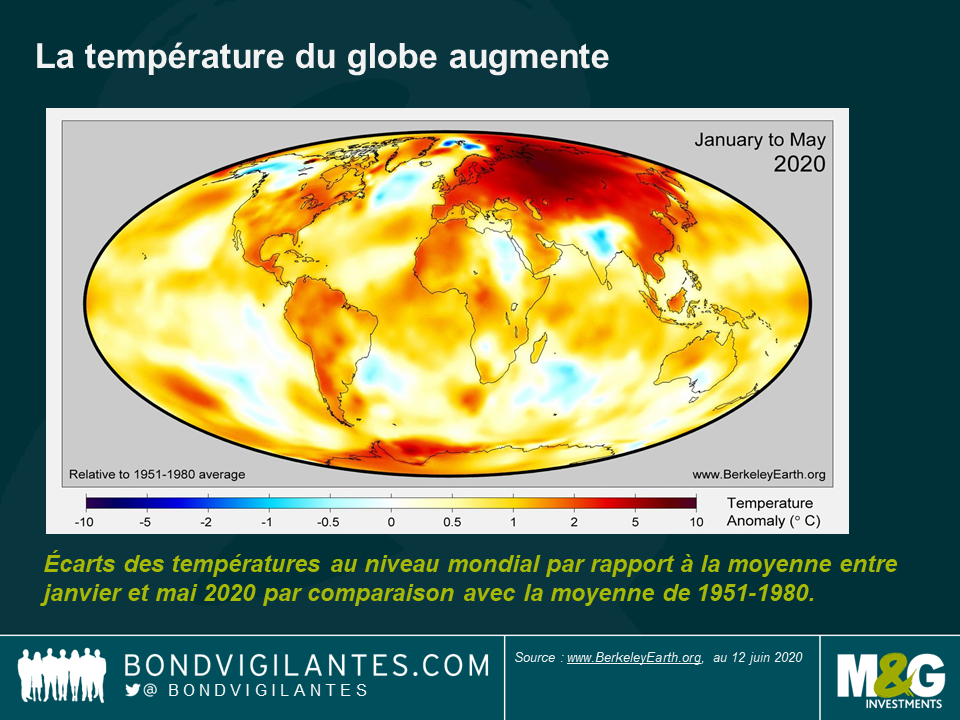
La demande mondiale d’énergie est appelée à continuer de croître au cours des 30 prochaines années, sous l’effet de l’augmentation de la population et de l’expansion économique. Et si les solutions renouvelables continuent de voir leur part de marché gagner du terrain, les combustibles fossiles devraient néanmoins encore représenter au moins 50 % du mix énergétique mondial en 2050 même dans le scénario le plus optimiste, selon la recherche de Barclays. Il en résulte que pour parvenir à un monde bas carbone, les entreprises existantes, en particulier les secteurs industriels, doivent décarboner et atténuer le risque climatique.
Toutefois, l’obstacle à l’émission d’obligations vertes par les entreprises à forte intensité carbone demeure élevé. En effet, ces émetteurs craignent d’arriver sur le marché avec une obligation verte et d’être critiqués pour cela. Il n’est ainsi pas surprenant que les groupes pétroliers et gaziers ne pèsent que 0,47 % dans l’indice BofA Merrill Lynch Green Bond, alors que leur poids dans l’indice BofA Merrill Lynch Global Corporate est de plus de 8 %. Malgré cela, je dirais que les entreprises opérant dans des secteurs industriels jouent un rôle important dans la transition énergétique dont nous avons besoin. Nombre d’entre elles sont des acteurs importants déjà dotés de larges structures capitalistiques et de départements de Recherche & Développement importants afin d’accélérer le changement indispensable. Le mois dernier, Total a acquis une participation de 51 % dans Seagreen 1, un projet de parc éolien offshore en mer du Nord estimé à 3 milliards de livres sterling. Peu d’acteurs ont la puissance de feu financière et la capacité d’assumer le risque de construction pour un projet aussi important.
Mais, qu’en est-il des activités qui ne peuvent être classées comme écologiques, mais qui jouent pourtant un rôle important dans la réduction de l’empreinte de gaz à effet de serre d’une entreprise ? Comment l’industrie de la gestion d’actifs peut-elle encourager un tel comportement pour les entreprises dont le cœur de métier n’est pas (encore) compatible avec un financement vert ?
Une solution possible pour permettre aux industries à forte intensité carbone de recevoir des fonds de la part des investisseurs responsables est l’émission d’obligations de transition énergétique. Il s’agit d’obligations émises dans le but de permettre d’évoluer vers un modèle économique plus écologique. Jusqu’à présent, cette idée n’en est qu’à ses débuts avec seulement une demi-douzaine d’obligations de ce type lancées. Le mois dernier, la société italienne de transport de gaz Snam a lancé sa première obligation de transition officielle via une opération de 500 millions d’euros. Le produit sera utilisé pour financer des projets éligibles liés à la transition énergétique, tels que définis par le Cadre d’obligations transitoires de la société. Par exemple, ce produit peut être lié à des projets d’énergie renouvelable en préparant des conduites de gaz pour hydrogène ou à des programmes d’efficacité énergétique en installant des chauffages dotés de technologies plus efficaces pour réduire les émissions de méthane. Cette nouvelle émission a été bien accueillie par les investisseurs obligataires et a été trois fois sursouscrite.
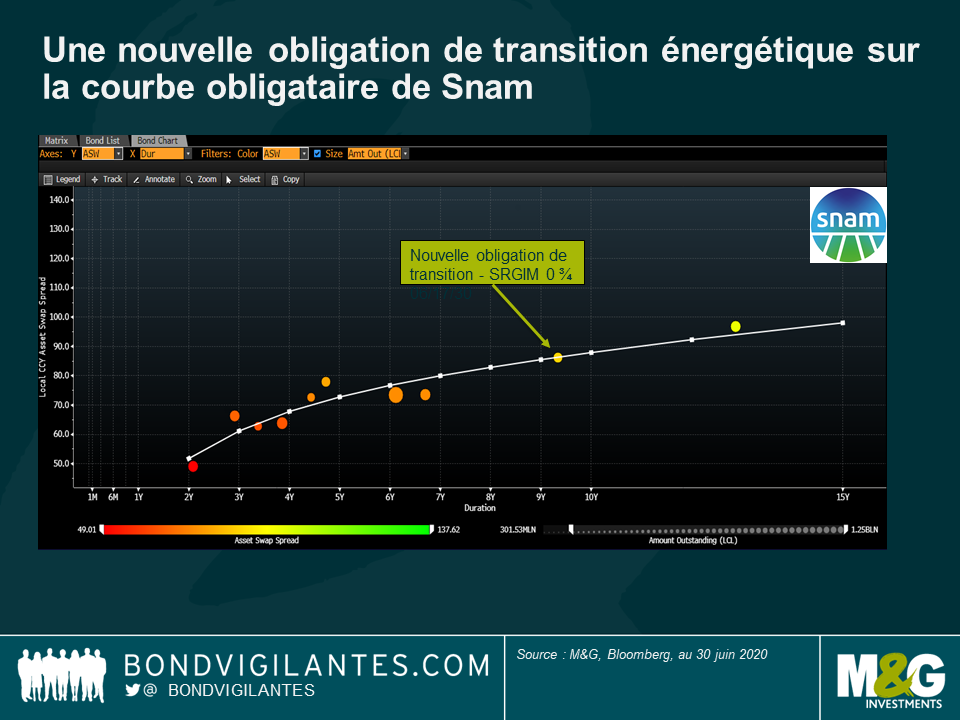
Pour autant, les premiers jours du marché des obligations de transition avaient suscité un peu de scepticisme de la part des investisseurs obligataires. En 2019, un producteur de viande bovine a émis une obligation de transition dans le but d’utiliser ces fonds pour acheter du bétail à des fournisseurs qui avaient accepté de ne pas détruire davantage de forêt tropicale. Nombreux ont été ceux estimant que l’entreprise n’aurait tout simplement pas dû acheter du bétail provenant de zones déboisées.
Cela souligne l’importance de l’existence de garde-fous et la nécessité de normes d’obligations de transition à l’échelle de l’industrie de la gestion d’actifs. Les acteurs du marché ont besoin d’un cadre de référence qui définisse les critères d’éligibilité pour l’utilisation du produit de l’émission de ces obligations de transition, notamment au regard des améliorations énergétiques minimales qui doivent être réalisées, de la manière dont elles sont mesurées et communiquées, et de la mesure dans laquelle une telle transaction doit être liée à la stratégie de transition plus globale de l’émetteur. C’est la seule façon de gagner la confiance des investisseurs et de permettre aux obligations de transition de devenir un marché plus accepté et plus profond. La taxonomie de l’UE va fournir des indications précieuses qui permettront de déterminer si l’utilisation prévue des fonds par une entreprise est suffisamment bonne pour pouvoir prétendre au statut d’obligation de transition. Si elles sont bien conçues, les obligations de transition peuvent offrir une importante classe d’actifs supplémentaire aux émetteurs, parallèlement aux obligations vertes, et ainsi contribuer à prévenir « l’écoblanchiment » sur le marché des obligations vertes.
Si le cadre de référence adéquat est mis en place, les obligations de transition énergétique pourraient constituer la prochaine évolution des investissements en faveur d’une économie bas carbone, combler un écart important et aider à mobiliser davantage d’actifs pour lutter contre le changement climatique. Les émetteurs pourraient ainsi obtenir un meilleur accès à une base d’investisseurs responsables de plus en plus importante, tandis que les investisseurs obligataires verraient l’éventail de leurs opportunités considérablement s’accroître, d’où au final un impact plus important en matière d’atténuation du risque climatique. Une situation dans laquelle tout le monde est gagnant : les investisseurs obligataires, les émetteurs et la planète.
Contrairement aux pays développés, les marchés émergents n’ont historiquement pas été capables d’utiliser la politique monétaire pour stimuler leurs économies pendant les crises. Ils ont généralement dû remonter leurs taux pour limiter les sorties de capitaux et défendre leur monnaie respective, rendant ainsi la reprise économique plus difficile.
C’est pourquoi il a été particulièrement intéressant d’observer les mesures qu’ils ont prises au cours de la crise du Covid-19 qui vient de balayer le monde. La plupart des banques centrales émergentes ont assoupli leur politique monétaire en abaissant leurs taux directeurs, certaines intervenant de façon très agressive (voir graphique ci-dessous), et je pense qu’elles disposent encore d’une marge pour en faire davantage. Cette évolution est très positive et sera utile pour soutenir l’activité économique au cours de cette période difficile. Ces baisses de taux sont en particulier à saluer car le financement en monnaie locale est progressivement devenu prépondérant dans de nombreux pays émergents qui avaient jusque-là l’habitude d’émettre de la dette essentiellement libellée en devises étrangères, le Brésil constituant à ce titre un bon exemple. Alors que de nombreuses monnaies émergentes avaient violemment corrigé au cours de la première phase de la crise, la plupart se sont fortement redressées depuis, et ce malgré ces réductions de taux directeurs. L’une des principales raisons ayant rendu ce rebond possible est la faible inflation à laquelle nous avons récemment assisté dans la plupart des pays émergents. En outre, les anticipations tablent sur une inflation qui devrait rester faible dans un avenir proche, la demande s’étant effondrée à cause de la pandémie. De même, la mesure de la Fed qui a baissé ses taux à des niveaux proches de zéro s’est avérée particulièrement utile.
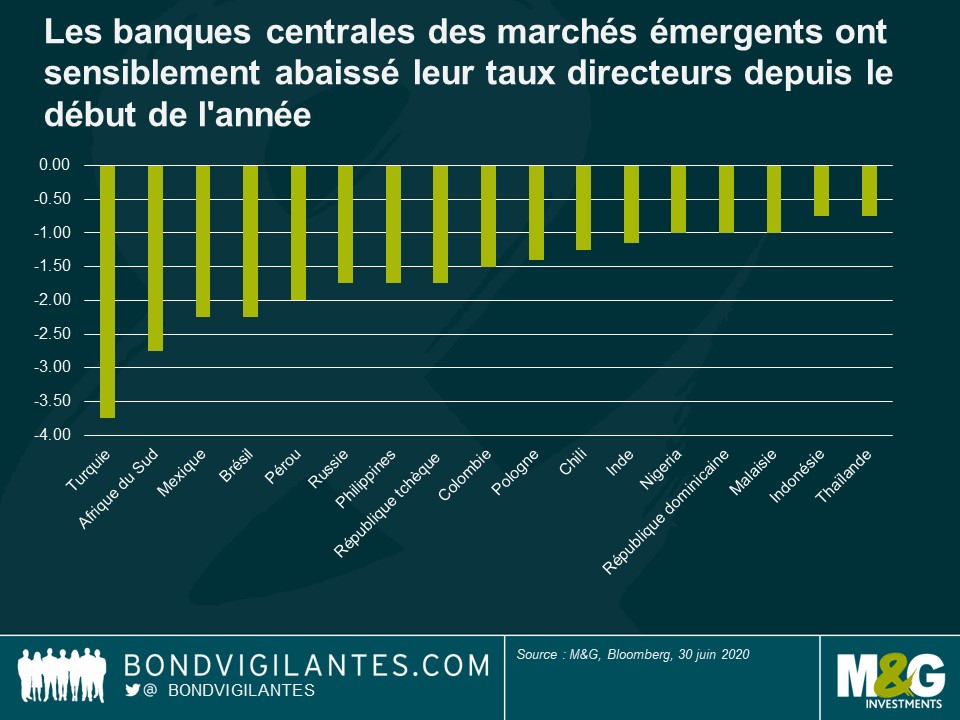
Même si cela a entraîné une chute des taux d’intérêt dans les pays émergents vers des niveaux historiquement bas, moins efficaces pour défendre les devises locales, l’écart de taux entre les pays émergents et les économies développées demeure important, la plupart des rendements réels émergents étant toujours en territoire positif (contrairement à ceux des marchés développés). De mon point de vue, les marchés émergents restent donc un segment de marché dans lequel les investisseurs à la recherche de rendement devraient être en mesure d’en trouver.
Point peut-être encore plus surprenant : plusieurs banques centrales émergentes se sont récemment lancées dans l’achat d’emprunts d’État, c’est-à-dire dans des « assouplissements quantitatifs » (QE). Cet outil était jusqu’à présent l’apanage des grandes banques centrales des marchés développés (voir le graphique ci-dessous pour plus de détails). Comme on peut s’y attendre, la taille de ces achats reste sensiblement inférieure à celle des marchés développés, et ressort dans la plupart des cas inférieure à 2 % du PIB. La taille des bilans des banques centrales émergentes reste faible comparée à celle des pays développés. Et celles présentant les plus gros bilans sont généralement les institutions disposant de grandes réserves de change plutôt que des emprunts d’État locaux. Une autre différence importante réside dans le fait que les banques centrales émergentes sont généralement loin d’avoir atteint la borne zéro en matière de taux directeurs, et la plupart d’entre elles ne devraient pas être en mesure de le faire. Cela soulève la question de l’efficacité relative des QE dans la mesure où l’arsenal de mesures monétaires classiques n’est pas encore épuisé.
À ce jour, la plupart des banques centrales émergentes ont procédé à un QE en achetant des emprunts d’État sur le marché secondaire, par opposition au marché primaire. Si certains affirment que le résultat final est quasiment identique, les achats sur le marché secondaire peuvent contribuer à dissiper les craintes que les banques centrales émergentes financent directement les déficits des États. Ces achats peuvent plutôt être considérés comme des opérations visant à fournir des liquidités et un soutien au marché en période de stress.
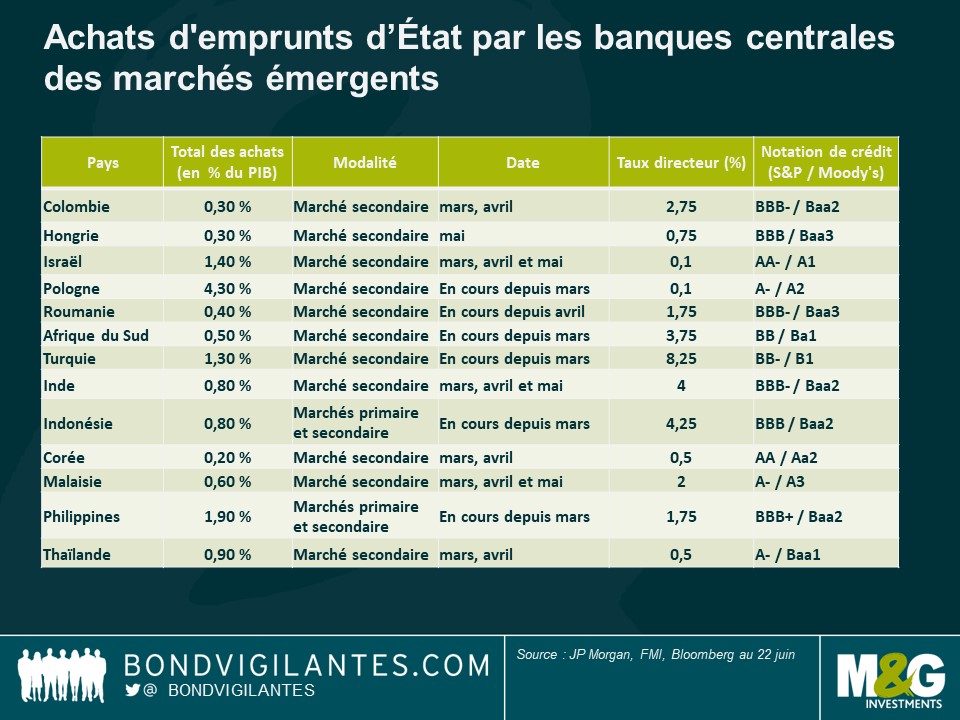
La majorité de ces pays qui se sont engagés dans un QE bénéficient d’une qualité de crédit relativement élevée (la plupart d’entre eux figurant en catégorie « investment grade ») et ont développé leurs marchés locaux, gagnant ainsi en crédibilité dans leur capacité à élaborer une politique budgétaire et monétaire. Les mesures prises par certains pays, comme par exemple l’Afrique du Sud ou la Turquie, qui se sont également engagés dans des achats d’actifs mais qui souffraient déjà d’un certain manque de crédibilité et suscitaient des doutes quant à l’indépendance de leur banque centrale, pourraient à long terme soulever encore plus de questions chez les investisseurs.
En tenant compte de la nature inédite de la crise actuelle, ces mesures de relance ont efficacement soutenu les marchés locaux, et le QE pourrait constituer un outil important à court terme pour aider à financer les déficits budgétaires croissants résultant de la crise. Toutefois, en fin de compte, le QE peut être considéré comme une forme de planche à billets. Cela pourrait devenir problématique à plus long terme si les investisseurs venaient à considérer que les pays utilisent cet outil pour contourner la discipline budgétaire, ce qui pourrait entraîner des sorties importantes des marchés locaux en cas de perte de confiance. Ces sorties alimenteraient à leur tour la dépréciation potentielle de leurs monnaies et l’inflation importée. Le ralentissement des achats d’actifs depuis mars dans la plupart des pays, sous l’effet d’une stabilisation des marchés et d’un redressement des prix des actifs, constitue un signal positif ; tout comme le fait que les pays émergents aient pu émettre des montants importants de dette locale au cours des deux derniers mois. Toutefois, la facilité avec laquelle il sera possible de faire marche arrière reste une question ouverte, et l’historique des marchés développés en matière de réduction progressive de QE ne constitue pas un précédent particulièrement encourageant.